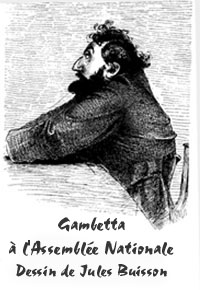![]()
LÉON GAMBETTA est né à Cahors (LOT- FRANCE) le 2-4-1838.
Il est mort le 31-12-1882.
Fils d'un immigré italien, épicier à Cahors, Léon Gambetta opte pour
la nationalité française en 1859. Après des études au petit séminaire,
il obtient une licence en droit. A Paris, il devient avocat puis
journaliste.
Le 14 novembre 1868, il
inaugure une brillante carrière en plaidant pour le républicain
Delescluze, inculpé d'avoir ouvert une souscription publique dans son
journal afin d'ériger un monument à la mémoire de Baudin, mort sur une
barricade du faubourg Saint-Antoine, le 3 décembre 1851. Jeune avocat,
accusateur de l'Empire autant que défenseur de son client, Gambetta fit
de ce procès un événement capital. Ce républicain convaincu
devint l'orateur qui
manquait à un parti plutôt
amorphe. Aux élections de mai 1869, Gambetta est candidat à Paris
contre Carnot et à Marseille opposé à Thiers. Il est élu dans
ces deux villes.
![]()
|
|
La même année, avec Brisson et Challemel Lacour, il fonde la Revue politique puis en 1871 la République française. Franc-maçon, républicain intransigeant face à l’Empire, il est élu à Belleville en 1869, sur la base d'un programme que les radicaux reprendront à leur compte. Député des Bouches-du-rhône en 1869-70, du 4-9-1870 au 6-2-1871, il est Ministre de l'Intérieur dans le gouvernement de Défense nationale issu de la révolution parisienne. Partisan de la guerre à outrance, le 4 septembre 1870, Gambetta est à la tête des «légalistes» qui veulent l’établissement de la République dans l’ordre.
![]()
| Le 7 octobre 1870, Gambetta chargé par le gouvernement de la défense nationale de diriger la guerre en province, quitte Paris en ballon pour organiser la levée de troupes en masse. Il organise à Tours un nouveau gouvernement qui procède à des levées d'hommes et à des achats d'armes et tente, avec des armées nouvelles, de secourir Paris assiégé. Au début de décembre, Tours étant menacée, la délégation se retire sur Bordeaux. Les conservateurs, que Gambetta exaspéraient, voulaient la paix ; à Lyon et dans le Midi, les révolutionnaires débordaient Gambetta. Dans Paris, le gouvernement avait donné des armes à la garde nationale, proche de l’opposition révolutionnaire qui réclamait une municipalité élue, la Commune. Le 20 janvier 1871, Paris capitule. Gambetta veut continuer la guerre. Thiers dénonce avec violence cette politique de « fou furieux ». Gambetta accepte l’armistice en janvier 1871, mais pour permettre de reprendre la «lutte à outrance», de Bordeaux il lance son appel à tous les Français, pour la défense du sol national. |
|
![]()
Leader de l'opposition républicaine sous l'Empire, il représente le
Bas-Rhin à l'Assemblée
Nationale du 8-2 au 1-3-1871, il démissionne
lorsque ses électeurs du Bas-Rhin sont abandonnés à l’Allemagne. Gambetta
député du Bas Rhin, quitte l'assemblée parmi les députés
d'Alsace-Lorraine et se retire en Espagne à Saint-Sébastien. De
nouveau député de la
Seine de1871 à 1882, il est Président
de la Chambre de 1879 à 1881
puis Président du Conseil et Ministre des Affaires Étrangères du
14-11-1881 au 27-1-1882
Doué d'un bon sens politique il
comprend la nécessité de gagner les masses rurales en leur offrant
l’image d’une république rassurante et modérée. Lors de ses voyages
en province, où il proclamait l’avènement des «couches nouvelles»,
il parvient à conquérir la confiance de nouvelles couches sociales
permettant ainsi d'asseoir socialement
le régime.
Le tribun radical s'oppose au cléricalisme et à nombre de ses amis
politiques. Pour Clemenceau il est un «renégat». Il s’aliène également
les grands intérêts capitalistes par ses projets de nationalisation des
chemins de fer
Blessé à la main, officiellement, en réparant son pistolet (on
a dit que c'est sa maîtresse Léonie Léon qui aurait tiré), alors que
sa blessure était presque guérie, le
8 décembre1882, il fut saisi de douleurs abdominales
qui provoquèrent
sa mort le 31.
![]()
LE PARTI RADICAL
(fin XIX ème début du XX ème siècle)
Le
Parti radical, en réalité, Parti républicain radical et
radical-socialiste est né le
21 juin 1901 à Paris. Bâti sur la doctrine
exprimée par différents comités radicaux dont les plus actifs étaient
animés par Gambetta
(Belleville, 1869) puis par Clemenceau (Montmartre, 1881), il comportait
parmi ses membres plusieurs personnalités qui avaient déjà été présidents
du Conseil (Ferdinand Buisson, Charles Floquet et Léon Bourgeois.
Le
Parti radical compte des tendances rivales autour de comités électoraux,
de loges maçonniques, de sections de la Ligue des droits de l’homme et
de la Ligue française de l’enseignement.
Le
Parti radical, parti de gauche à conviction laïque fonctionne sous
l'influence de notables et de parlementaires membres de droit du comité
exécutif élu chaque année par un congrès. Laïque et anticlérical, il
a les faveurs des milieux petit-bourgeois et paysans des pays du sud de la
France.
Au
début du XX ème siècle, les
radicaux, conservateurs en matière sociale, se déclarent «résolument
attachés au principe de la propriété privée»
Parmi
les personnalités les plus marquantes ayant appartenu au Parti radical,
on notera particulièrement le président du Conseil Émile Combes
(1902-1905), qui dirige le parti jusqu’en 1913. C'est Joseph Caillaux
qui lui succèdera. Clemenceau, bien que participant peu
à la vie du parti, est président du Conseil de 1906 à 1909
![]()